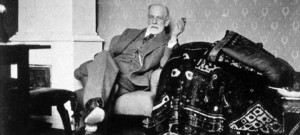Enregistrer l'article en PDF
Enregistrer l'article en PDFFreud prédisait dès 1928 un sombre avenir de la psychanalyse si elle devait devenir une spécialité médicale. Si ce n’est pas le cas formellement, l’évolution va dans ce sens dans la mesure où la psychanalyse est de plus en plus envisagée comme un soin/médicament ; tout un échantillonage de nouveaux usagers venant à elle dans une parfaite ignorance avec des demandes extravagantes de guérison miraculeuse.
Freud réitère sa position à Ferenczi dans une lettre du 22 avril 1928 où il écrit : « Le développement interne de la psychanalyse va partout, à l’encontre de mes intentions, s’écartant de l’analyse profane vers une spécialité purement médicale, ce que je considère comme néfaste pour l’avenir de l’analyse. En fait, je ne suis sûr que de vous, à savoir que vous partagez sans réserve mon point de vue. » [1] Le 13 mai 1928, soit dans la même période, il dit son pessimisme en écrivant à Ferenczi du « sombre avenir de la psychanalyse si elle ne parvient pas à se créer une place en dehors de la médecine » (9). [2] Une année plus tard le 27 avril 1929, il écrira toujours à Ferenczi que l’hostilité à la psychanalyse laïque est « Le dernier masque de la résistance à l’analyse, le masque médico-professionnel est le plus dangereux pour l’avenir. » [3]
Au 12ème Congrès de l’IPA à Wiesbaden en septembre 1932 (Max Eitingon est toujours président), décision est prise que chaque société psychanalytique sera libre de choisir ses propres critères pour choisir ses candidats, médecins ou laïques. [4]
Au 15ème Congrès de l’IPA à Paris (le président est maintenant Ernest Jones), l’Association psychanalytique américaine dont dépendaient les sociétés locales des USA complique à nouveau les choses en posant des conditions draconiennes pour entrer à l’IPA, en partie en demandant une indépendance pour choisir ses critères d’affiliation par rapport à cette même IPA car ceux choisis par la commission internationale de l’enseignement paraissaient aux « américains » trop en faveur de la psychanalyse laïque. Jones arrive de justesse à éviter une division USA/Europe mais sans résoudre le problème de la psychanalyse laïque. [5]
Freud ne cédera jamais sur cette question car une rumeur absurde se répand aux USA aux environs des années 1930 qui colporte que Freud serait devenu finalement favorable aux positions américaines en faveur de la psychanalyse médicale et en défaveur de la psychanalyse laïque.
Dans une riposte du 5 juillet 1938, Freud écrit à un certain M. Schnier :
« Je ne puis imaginer d’où peut provenir cette stupide rumeur concernant mon changement d’avis sur la question de l’analyse pratiquée par les non-médecins. Le fait est que je n’ai jamais répudié mes vues et que je les soutiens avec encore plus de force qu’auparavant, face à l’évidente tendance qu’ont les Américains à transformer la psychanalyse en bonne à tout faire de la psychiatrie.
Bien à vous, Sigmund Freud » [6]
Il est particulièrement intéressant de noter que dès 1913, Freud était déjà favorable à une pratique non-médicale. Lisons-le : « La question se pose seulement de savoir si l’exercice de la psychanalyse ne présuppose pas un apprentissage médical dont l’éducateur et le ministre des âmes doivent rester privés, ou si d’autres circonstances ne s’opposent pas à l’intention de mettre la technique psychanalytique en d’autres mains que des mains médicales. J’avoue que je ne vois aucune raison à de telles réserves. […] ; or la majorité des médecins n’est pas armée pour la pratique de la psychanalyse et a été totalement défaillante lorsqu’il s’agissait de prendre en compte ce procédé curatif. […] La garantie d’une application sans dommage du procédé analytique ne peut cependant […] être apportée que par la personnalité de celui qui analyse. » [7]
Cette question est en ce début de millénaire remise sur le tapis indirectement en France car le législateur voudrait protéger « l’usager » des psychothérapies par définition, selon ce même législateur, fragile. C’est ainsi que les psychothérapies (PNL, sophrologie, gestalt, etc.) proprement dites sont désormais régies par l’article 91 [8] de la loi HPST du 21 juillet 2009. L’initiative est en soi louable car la pléthore de psychothérapies en tout genre qui n’arrêtait pas d’enfler (il y en a des centaines en Californie), y compris des pratiques magiques, avait de quoi affoler. Mais cette législation ne changera rien dans la mesure où une pratique peut quitter l’appellation de psychothérapie et rejaillir dans une autre catégorie professionnelle.
La psychanalyse s’est sentie visée car du côté du médical, elle est nettement assimilée à de la psychothérapie (psychothérapie dynamique) : Freud serait consterné qu’on veuille refaire de la psychanalyse une bonne à tout faire de la médecine. Ceci dit, elle reste encore indépendante dans ses grandes lignes.
Concrètement presque partout en Europe, la législation est intervenue pour tirer la psychanalyse vers la médecine et la psychologie (discipline dorénavant reconnue par les Etats). Souvent, liberté est cependant laissée aux sociétés de psychanalyse de choisir ses critères ou encore de ne pas assimiler la psychanalyse à de la psychothérapie.
Déjà, vers les années 1950, plusieurs procès eurent lieu à la demande de l’ordre des médecins. L’affaire Margaret Clark-Williams, psychanalyste laïque pour enfants au Centre Claude Bernard, est la plus connue. Elle fut condamnée en appel (après une première relaxe en 1952) à une peine de principe (1953) même si ses qualités morales furent reconnues suite à une insistance de l’ordre des médecins. D’ailleurs, certains médecins, scandalisés refusèrent de témoigner à charge telle que Jean Delay (psychiatre hospitalier et philosophe, 1907-1987) ou André Berge (psychiatre, psychanalyste, 1902-1995) et le suisse John Leuba (psychiatre, psychanalyste, 1884-1954).
Finalement, un arrêté du tribunal correctionnel de Nanterre (9 février 1979) reconnaîtra que la médecine est étrangère à la psychanalyse laïque qui deviendra juridiquement libre (Jacques Lacan [1901-1981] y est pour beaucoup dans sa défense de la psychanalyse laïque surtout contre Sacha Nacht [1901-1977], fervent partisan de la psychanalyse médicale).
En Suisse, c’est Charles Baudouin qui fut tracassé par l’administration, alors que tout le monde sait qu’il s’agit d’une très grande figure internationale de la psychanalyse (voir l’article en bibliographie de Mireille Cifali, professeure à l’université de Genève, historienne et psychanalyste).
Comme le dit justement [9] Ana Beatriz Lima da Cruz dans son article « En question : L’analyse profane / laïque… » [10] en 2003, la psychanalyse pose ipso facto des problèmes, voire des malaises dit-elle : « Ce sont des malaises tels que : pourquoi la psychanalyse ? Elle a encore de la place ? Elle est indiquée dans quelles circonstances ? Y a-t-il une psychanalyse de cabinet et une autre des institutions ? Qu’est-ce qu’un analyste fait ? Qu’est-ce que c’est un analyste ? Il s’agit d’un type sérieux, sadique, dépourvu de corps, arrogant, tout-puissant qui porte Louis XIV dans le ventre, qui est-ce finalement ? Qu’est-ce que c’est le processus psychanalytique ? Et les nouvelles psychothérapies dépasseront la psychanalyse, marcheront dessus, occuperont sa place ?
Rêve, quel rêve, les bêtes rêvent comme l’homme, cela est une bêtise.
Conflit, quel conflit, il n’y a plus de culpabilité, nous sommes vidés des passions. Si la psychanalyse était appuyée sur ça — sur le conflit psychique — elle a perdu le moment. Et l’industrie pharmaceutique, on n’y pense pas, il s’agit d’une compétition déloyale, ses armes sont beaucoup plus puissantes. Nous sommes formatés, mises en boîte… »
Il ne s’agit pour moi aucunement d’être prosélyte de la psychanalyse d’autant plus que si un savoir se sait grâce à elle, c’est celui de l’inconscient. Si la psychanalyse doit disparaître, elle disparaîtra. Mais à l’aune de ce que disait Freud, je cite de mémoire : « ce n’est pas parce que le savoir théorique en psychanalyse ne sert à rien (dans le sens de faire des progrès vers une évolution psychique et une connaissance de soi-même) qu’il faille se priver d’écrire à son sujet sans quoi elle ne pourra jamais exister ».
M’inscrivant exactement dans cette filiation, je pense qu’il faut encore et encore écrire sur la psychanalyse pour ceux qui en ont un besoin vital. Le but n’est certainement pas de tenter à n’importe quel prix d’en préserver l’existence mais de la recentrer par rapport à la pléthore actuelle de thérapies qui promettent la lune à leurs patients.
Il faut affirmer l’identité de la psychanalyse pour que les sujets souffrants sachent exactement quel est leur projet quand ils vont voir un praticien psychanalyste.
Christian Jeanclaude
Strasbourg
Notes
[1] Sigmund Freud/Sandor Ferenczi, Correspondance 1920-1933 Les années douloureuses, Paris, Calmann Levy, 2000 : 378
[2] Ib., p. 380.
[3] Ib., p. 411.
[4] JONES (E.), (1957), La vie et l’oeuvre de Sigmund Freud, volume 3, trad. fr., Paris, PUF, 1975 : 340.
[5] JONES (E.), La vie et l’oeuvre de Sigmund Freud, volume 3, op . cit.trad. , p. 342.
[6] ROUDINESCO (E.), PLON (M.), « La question de l’analyse profane », Dictionnaire de la psychanalyse, Paris, Fayard, 1997 : 869.
[7] FREUD (S.), Préface de Freud à l’« Introduction à la méthode psychanalytique du Dr Oskar Pfister », OCF.P XII, Paris, PUF, 2006 : 39.
[8] Article 52 Modifié par la loi n°2009-879 (loi n° 2009-879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires [loi HPST]) du 21 juillet 2009 – art. 91. Modification appelée aussi article 52/91 par les professionnels.
[9] Je laisse la traduction en l’état telle que je l’ai trouvée même si elle me paraît d’une qualité douteuse.
[10] LIMA DA CRUZ Ana Beatriz « En question : L’analyse profane / laïque … », États généraux de la psychanalyse : Seconde Rencontre Mondiale – Rio de Janeiro, 2003.